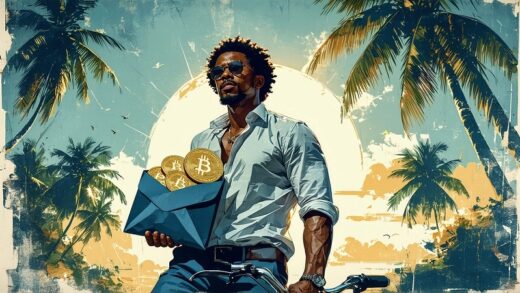Dans les ruelles discrètes de Kaboul, derrière des fenêtres closes et des rideaux tirés, une révolution silencieuse se joue. Elle ne se mesure pas en manifestants dans la rue, mais en lignes de code, en clés privées, en transactions peer-to-peer. Depuis la prise de pouvoir des talibans en août 2021, les femmes afghanes ont vu leurs droits fondamentaux — à l’éducation, au travail, à la liberté de mouvement — systématiquement effacés. Pourtant, dans ce paysage de répression, une nouvelle forme de résilience émerge : la cryptomonnaie, devenue pour des milliers de femmes un outil de survie, d’autonomie et de dignité.
Ce n’est pas une simple adoption technologique. C’est une stratégie de contournement face à un système qui les exclut. Alors que les banques refusent leurs comptes, que les emplois leur sont retirés et que les déplacements sont surveillés, le Bitcoin et autres actifs numériques offrent une porte de sortie : une monnaie qu’aucun régime ne peut confisquer, bloquer ou surveiller sans leur consentement.
Une monnaie hors du contrôle des talibans
Les talibans ont interdit les cryptomonnaies dès 2022, les qualifiant de haram — contraire à la loi islamique. Pourtant, loin de disparaître, l’usage du Bitcoin s’est enfoncé dans l’underground. Grâce aux réseaux P2P (peer-to-peer) comme LocalBitcoins ou Paxful, les femmes échangent des dollars, des roupies pakistanaises ou des biens contre des satoshis, souvent via des intermédiaires de confiance. Ces transactions, anonymes et décentralisées, échappent à la surveillance étatique.
« Le Bitcoin est devenu un outil de survie », explique Roya Mahboob, fondatrice du Digital Citizen Fund (DCF), une organisation qui forme secrètement des femmes afghanes à la littérature financière et numérique. « Quand vous ne pouvez pas ouvrir de compte bancaire, quand votre salaire est bloqué, quand votre mari ou votre frère contrôle chaque roupie que vous dépensez… posséder une clé privée, c’est posséder votre liberté. »

Cette liberté est concrète. Une mère de famille peut recevoir de l’aide de sa diaspora sans passer par un système bancaire corrompu ou contrôlé. Une enseignante licenciée peut vendre des cours en ligne et être payée en crypto. Sans que les autorités ne puissent tracer l’origine de ses revenus. Une étudiante peut épargner pour fuir le pays, son capital numérique caché dans un mot de passe mémorisé. Pas dans un coffre vulnérable aux perquisitions.
Éduquer dans l’ombre : les écoles clandestines du code
Mais la résistance ne se limite pas à l’usage. Elle passe aussi par l’apprentissage. Face à l’interdiction de l’éducation secondaire et universitaire pour les filles, des initiatives clandestines se multiplient. L’une des plus audacieuses est l’International Blockchain Academy, lancée par Ahmad Jawed Sikandar via la Thinkify Foundation.
Depuis chez elles, une centaine de jeunes femmes suivent des cours en ligne sur la blockchain, le codage, l’analyse de données et les smart contracts. Les sessions sont diffusées en direct, les devoirs rendus via des plateformes sécurisées, les diplômes délivrés sous pseudonyme. « Nous ne voulons pas de buzz », confie Sikandar. « Si les talibans découvrent ces cours, elles risquent la prison, voire pire. »
L’objectif est clair : préparer ces femmes à un avenir professionnel global. « Avec un ordinateur et une connexion, elles peuvent travailler pour des entreprises à Dubaï, à Berlin ou à San Francisco. Elles ne dépendront plus d’un système qui les opprime. » La blockchain, dans ce contexte, n’est pas une mode technologique : c’est un passeport numérique, une compétence exportable, une voie vers l’indépendance économique.
A lire aussi : Bitcoin en Birmanie, la crypto qui glisse entre les mailles du régime
Les défis des femmes afghanes : connectivité, sécurité, et persécution
Cette révolution n’est pas sans risques. L’Afghanistan souffre d’un accès internet extrêmement limité, surtout en zone rurale. Les coupures fréquentes, la censure étatique et le coût élevé des données rendent l’apprentissage difficile. Pire, la simple possession d’un portefeuille crypto peut être punie sévèrement si découverte.
Les femmes doivent donc ruser : utiliser des VPN, stocker leurs clés sur du papier plutôt que sur des appareils traçables, effacer régulièrement leur historique de navigation. Certaines transforment leurs clés privées en poèmes ou en versets coraniques, dissimulant leur trésor numérique dans des formes culturellement acceptables.
Malgré ces dangers, l’engagement ne faiblit pas. « Elles savent que chaque ligne de code apprise est une brique de plus dans le mur qu’elles construisent contre l’oppression », dit une formatrice anonyme citée par Ideas Beyond Borders.
Au-delà de l’Afghanistan : un modèle de résistance numérique
L’expérience afghane résonne bien au-delà des frontières du pays. Elle illustre une vérité profonde du Web3. La technologie décentralisée n’est pas qu’un outil spéculatif — elle est un bouclier pour les opprimés.
Des journalistes en Turquie aux activistes au Venezuela, des minorités religieuses en Iran aux dissidents en Chine, des millions de personnes utilisent déjà les cryptomonnaies pour contourner la censure, préserver leur patrimoine ou financer leur exil. Mais en Afghanistan, ce phénomène atteint une intensité unique, car il s’inscrit dans une lutte existentielle pour la dignité féminine.
Ce que les femmes afghanes construisent n’est pas seulement un portefeuille. C’est une économie parallèle, invisible mais résiliente, où la valeur n’est pas dictée par un mollah ou un banquier, mais par la confiance mathématique et la cryptographie.
La liberté des femmes afghanes, une clé privée à la fois
Dans un pays où les droits humains sont de plus en plus fragiles, l’Afghanistan devient un laboratoire tragique — mais aussi inspirant — de la résistance numérique. Les femmes qui, dans le secret de leur chambre, apprennent à signer une transaction Bitcoin, ne font pas que gérer de l’argent. Elles affirment leur souveraineté personnelle. Elles prouvent que même dans les régimes les plus totalitaires, il existe des espaces que le pouvoir ne peut pas coloniser. Tant que l’esprit reste libre, et que la clé reste secrète.
Leur message est clair : quand on vous enlève tout, gardez au moins votre clé privée. Car c’est là, dans ces 64 caractères aléatoires, que réside la dernière frontière de la liberté.